Pépites de managementRetrouvez ici quelques pépites issues de notre veille des meilleures publications sur le leadership et le management
Performance

Et si retirer la peur de l'échec suffisait à libérer la créativité ?
Parmi tous les facteurs de réussite d'une équipe, la sécurité psychologique arrive en tête. Pourtant, la majorité des salariés avouent ne pas oser s'exprimer au travail.
Rafael Chiuzi, psychologue organisationnel, a mené une expérience lors d'un cours universitaire impliquant un projet créatif. Après avoir demandé à ses étudiants ce qui les effrayait le plus et obtenu pour réponse : « Avoir une mauvaise note », il leur a fait une proposition surprenante : « Je vous garantis que tant que votre projet est authentique et créatif, vous obtiendrez une note correcte, au-dessus de la moyenne. »
Les étudiants ont d'abord ri, pensant à un piège. Mais une fois convaincus, la tension s'est évaporée. Il en a résulté des projets de meilleure qualité, plus d'amusement, plus d'audace.
Trois enseignements clés se dégagent :
– Retirer la peur libère l'énergie cognitive. Le cerveau peut enfin se consacrer à la création plutôt qu'à la gestion de l'anxiété.
– Des garanties de sécurité sont nécessaires. Dire : « Vous pouvez vous exprimer » ne suffit pas. Il faut créer des conditions tangibles de sécurité.
– Disposer d’un espace d’expérimentation nourrit le développement. La liberté d’échouer autorise la prise de risque et ainsi, l’apprentissage.
Et vous, à quand votre première réunion avec « filet de sécurité » ?
__________
Source : The most powerful predictor of team success, Rafael Chiuzi, TEDxMcMasterU, mars 2022.
Pour en savoir plus :
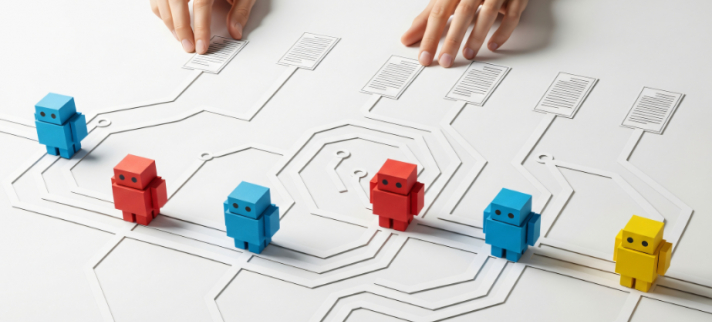
L'IA : avant tout une affaire humaine
Investir massivement dans la technologie IA ? Vous risquez l'échec. Une étude BCG auprès de 1 250 dirigeants révèle que les obstacles à la création de valeur par l'IA sont d'abord humains et organisationnels. La plupart des échecs proviennent de l'adoption, de la gouvernance et de la transformation des processus, pas de la performance technique.
Les 5 % d'entreprises qui génèrent le plus de valeur se distinguent par trois natures d’investissement :
– Former massivement. Elles prévoient aujourd’hui de former plus de 50 % de leurs employés en 2025, contre seulement 20 % chez les entreprises les moins performantes. Elles sont également quatre fois plus susceptibles de dégager du temps dédié à l'apprentissage. Résultat : les collaborateurs qui utilisent l’IA quotidiennement y sont de 50 % plus nombreux qu’ailleurs.
– Construire avec les équipes. Elles impliquent leurs équipes deux fois plus souvent que les autres dans la refonte des processus s’appuyant sur des agents IA., ce qui facilite l'adoption et la confiance.
– Opérer avec un modèle de données unique. 50 % des entreprises les plus performantes fonctionnent avec un modèle de données unifié dans l'organisation, contre seulement 4 % des moins performantes.
Et si, pour votre prochain investissement IA, vous commenciez par regarder du côté de vos équipes ?
----------
Source : The Widening AI Value Gap, Boston Consulting Group, septembre 2025.

300 postes, 13 000 compétents : le paradoxe qui révèle un angle mort de l’organisation
Les entreprises organisent leur travail autour de la notion de postes depuis plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, face à la volatilité économique et à l'IA, cette approche montre ses limites. D'où l'émergence de l'approche par compétences (skills-based approach) : plutôt que de penser : « De quels postes avons-nous besoin ? », les organisations se demandent : « De quelles compétences disposons-nous et comment les mobiliser ? »
Ce changement de paradigme révèle des surprises. Bill Winters, directeur général de la banque Standard Chartered, a ainsi demandé : « Quelle est notre capacité en data science ? » Pour y répondre, le premier réflexe consistait à compter les postes correspondants : Standard Chartered en avait 300. Mais en réalité, la banque comptait près de 13 000 personnes, sur environ 85 000 salariés, possédant des compétences en data science – soit un ratio de 1 à 43.
Il en ressort trois enseignements clés :
– L'invisibilité des compétences. Se fier aux intitulés de poste revient à sous-estimer les capacités réelles de l'organisation.
– Le coût de l'angle mort. La méconnaissance du vivier de compétences entraîne d’importants coûts de recrutement.
– La mobilité comme levier. Cartographier les compétences réelles permet de redéployer les talents vers les besoins émergents, en évitant des coûts financiers et humains de restructuration.
Et si votre organisation sous-estimait, elle aussi, ses capacités d'un facteur 10 ou 20 – voire plus ?
----------
Source : Building Skills-Powered Organizations for the Future, Ravin Jesuthasan, Wharton School, YouTube, juillet 2025.
Pour en savoir plus :

Vos managers intermédiaires ont-ils intégré l’IA dans leurs pratiques ?
« L’IA ne remplacera pas les humains, mais les humains avec IA remplaceront les humains sans IA », affirmait Karim Lakhani, professeur à la Harvard Business School, dès 2023. La révolution initiée par l’IA est en marche : un aspect encore peu abordé est l’impact qu’elle aura sur les fonctions managériales.
La peur de se voir remplacé par des machines est bien sûr présente – et la perspective de voir des IA spécialisées nous manager peut donner des sueurs froides. La réalité sera bien sûr plus nuancée, mais il s’agit néanmoins d’une révolution existentielle pour le management intermédiaire. Si ce niveau de management n’est plus celui qui connaît et diffuse l’information ; si ce n’est plus par lui que passe la coopération entre services ; s’il n’incarne même plus celui qui comprend, donne du sens et remet en question les idées de ses collaborateurs, car des prompts bien pensés peuvent remplir cette fonction, qu’advient-il de son rôle ? Celui-ci va devoir être affiné progressivement, par expérimentation.
À court terme, il est clair que la révolution de l’IA doit s’appuyer sur cette strate hiérarchique et que le succès dépendra en très grande partie de son adhésion au sujet. Cela suppose que ces managers développent leur connaissance de ces outils, qu’ils aient à l’esprit d’explorer en permanence ce qu’ils peuvent en tirer, et qu’ils développent leurs compétences pour le faire.
Avez-vous déjà lancé ce chantier ?
----------
Source : Succeeding in the Digital Age, Harvard Business Impact, février 2025.
Pour en savoir plus :

Chroniquement débordés, tout en restant performants et motivés… Comment font-ils ?
Épidémie de burn-out, démission silencieuse… Plus personne n’ignore le sens de ces expressions, emblématiques de l’intensification du travail. En avril 2025, la consultante Melissa Swift a interrogé 1 000 professionnels, tous niveaux hiérarchiques confondus. Sans surprise, 75 % des répondants ont indiqué se sentir écrasés par la charge et submergés, au moins une partie du temps.
Plus étonnamment, 12 % des répondants se sentent performants et motivés malgré la surcharge. L’auteur a étudié ceux qu’elle surnomme les « fleurs du désert », parce qu’ils s’épanouissent en milieu hostile. Leur secret ? Ils mènent trois combats au quotidien :
– Réduire le volume de tâches. Ces professionnels sont 43 % plus nombreux que la moyenne à négocier, déléguer ou supprimer les activités à faible valeur ajoutée.
– S’offrir des plages d’autonomie. Ils sont 55 % plus enclins à décomposer un projet en tâches individuelles ou à refuser une réunion pour mieux avancer en solo — une posture résolument à contre?courant dans des organisations obsédées par la collaboration constante.
– Assainir les émotions. 48 % d’entre eux instaurent régulièrement des « pauses positives », qui ressoudent l’équipe et font retomber la pression.
Et si, vous aussi, vous deveniez une « fleur du désert » ?
----------
Source : How Leaders Fight Back Against Overwork, Melissa Swift, MIT Sloan Management Review, juin 2025.
Pour en savoir plus :